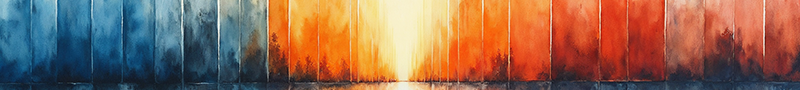↓ Dernière modification de cet article ↓
L’OFSP en tant que responsable de la surveillance de la radioactivité dans l’environnement, mesure en permanence la radioactivité dans l’air en Suisse à l’aide de son réseau automatique de mesure de la radioactivité dans l’air URAnet et de son réseau de collecteur à très haut débit (HVS). Depuis le début de l’attaque militaire russe contre l’Ukraine, de possibles rejets de radioactivité dans l’environnement sont sources de préoccupations. En effet, outre le fait que la zone d’exclusion de Tchernobyl se situe en zone de combat, l’Ukraine exploite 15 réacteurs nucléaires sur 4 sites, qui représentent un risque accru en cas de guerre. En Suisse, la centrale nationale d’alarme (CENAL) est en engagement et reçoit les informations de l’agence internationale pour l’énergie atomique (AIEA); l’OFSP est en en contact régulier avec les experts du Ring Of Five, un réseau d’échanges d’informations entre laboratoires européens spécialisés dans la mesure de la radioactivité dans l’air, dont il fait partie.
Pour l’heure, aucune valeur anormale de radioactivité n’a été détectée en Suisse, ni dans les autres pays européens.
pour plus d’information voir aussi :
- Comprimés d’iode en cas d’événement nucléaire à l’étranger
- Office fédéral de la protection de la population – OFPP – Informations actuelles concernant la protection de la population
Situation en Ukraine
Depuis le 23 janvier 2023, des collaborateurs de l‘Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) surveillent en permanence la situation sur tous les sites des centrales nucléaires ukrainiennes. L’AIEA a exprimé à plusieurs reprises son inquiétude quant à une exploitation durablement sûre des centrales nucléaires ukrainiennes. La centrale nucléaire de Zaporijia, en particulier, a été exposée à plusieurs reprises à des bombardements et à des interruptions de l’alimentation électrique externe depuis le début de l’offensive russe en Ukraine. Début avril 2024, la centrale nucléaire a été attaquée par des drones. Le 11 août 2024, un incendie s’est déclaré sur une tour de refroidissement et un nuage de fumée sombre s’élevant du site a été observé. Bien que ces événements n’aient pas eu de conséquences immédiates sur la sûreté nucléaire de la centrale, ils augmentent le risque d’un accident nucléaire, a déclaré M. Grossi, directeur général de l’AIEA.
Evénements précédents :
Le 6 juin 2023, le barrage de Kakhovka a été gravement endommagé. La centrale nucléaire de Zaporijia étant située en amont du barrage, elle n’était donc pas menacée par une inondation. Selon l’évaluation de l’AIEA, qui a envoyé ses propres experts sur place, il n’y avait pas non plus de danger immédiat.
Certains médias ont rapporté que de la radioactivité aurait été libérée en Ukraine le 13 mai 2023 suite à une explosion en lien avec des munitions à uranium appauvri. Aucune mesure n’a, à notre connaissance, pu confirmer une telle libération de radioactivité.
Selon les autorités ukrainiennes, les forces armées russes ont rendu fin mars 2022 le contrôle de la centrale nucléaire désaffectée de Tchernobyl au personnel ukrainien. La centrale nucléaire de Tchernobyl se trouve dans la zone d’exclusion mise en place après l’accident de 1986. Jusqu’à présent, il n’y a pas eu de rejet de radioactivité.
En été 2022, des incendies de forêt ont démarré dans la région de Tchernobyl. Leurs effets sont toutefois restés largement locaux.
Dans la ville de Kharkiv, une nouvelle installation de recherche nucléaire a été la cible d’attaques russes à plusieurs reprises. L’installation sert à la recherche et au développement ainsi qu’à la production de radio-isotopes pour des applications médicales et industrielles. Le 26 février 2022, des missiles se sont abattus sur le site d’un entrepôt de déchets radioactifs, également situé dans la région de Kharkiv, sans toutefois endommager le bâtiment ni libérer de substances radioactives.
Pour plus d’informations:
———————————
Le césium-137 dans la basse atmosphère
La section Radioactivité de l’environnement (URA) de l’OFSP surveille en permanence la radioactivité dans l’air à l’aide de son réseau automatique URANet. Les stations de mesure transmettent des résultats toutes les 5 minutes et des alarmes sont générées automatiquement en cas de valeurs plus élevées. Les résultats de mesure sont publiés toutes les 12 h sur Radenviro. Si ce dispositif est assez sensible pour détecter une élévation anormale de radioactivité dans l’air, il n’est pas en mesure de mesurer les traces de Cs-137 encore présentes dans l’air en Suisse, comme conséquence de l’accident de Tchernobyl de 1986 ainsi que des essais atomiques des années 60. Pour réaliser ces mesures de traces, il entretient un réseau de collecteurs d’aérosols à haut débit (HVS) pour mesurer la radioactivité liée aux aérosols dans l’air extérieur. Les filtres sont changés chaque semaine, mais la fréquence peut être adaptée selon les événements, puis mesurés en laboratoire par spectrométrie gamma (HPGe). Les valeurs mesurées pour les derniers mois sont indiquées ci-dessous en micro-becquerel par mètre cube (µBq/m3).
Des traces de césium-137 (Cs-137) sont souvent détectées, avec des valeurs allant jusqu’à plusieurs µBq/m3 dans les échantillons des collecteurs à haut volume. Il s’agit là de remise en suspension d’anciennes dépositions au sol (par exemple, les dépositions de l’accident de Tchernobyl de 1986). La limite de détection pour le Cs-137 est typiquement de 0.2 µBq/m3. Les limites de détection sont représentées par des triangles non remplis dans le diagramme ci-dessous.
A l’aide de ces deux dispositifs complémentaires l’OFSP est à même d’assurer une surveillance à la fois réactive et extrêmement sensible de la radioactivité dans l’air en Suisse, et garantit que toute trace de radioactivité artificielle puisse être détectée.